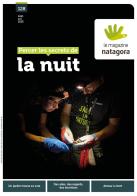Amour à mort chez l’épeire diadème
Chez l’épeire diadème, comme chez la plupart des araignées, la reproduction n’est pas une idylle… du moins pas pour le mâle. Elle s’apparente plutôt à une mission à haut risque, sur fond de cannibalisme, parfois même avant qu’il n’ait pu s’accoupler.
L’épeire diadème (Araneus diadematus) est une espèce d’araignée relativement commune, visible dans les jardins et ailleurs. On la reconnaît facilement à la croix formée par des points blancs sur son abdomen, motif qui rappelle un diadème, d’où son nom.
Chez la plupart des araignées adultes, le mâle est nettement plus petit que la femelle. Mais au-delà de la taille, la forme des pédipalpes – des appendices tactiles situés près de la bouche – constitue un autre critère visuel de distinction. Chez la femelle, ils ressemblent aux autres pattes, avec une extrémité fine et discrète. Chez le mâle, chaque extrémité est élargie et creusée, formant les bulbes copulateurs ou embolus, une structure en forme de gant de boxe, indispensable à l’accouplement.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’accouplement ne se fait pas par simple contact des extrémités abdominales : les organes reproducteurs se situent sur la face ventrale de l’abdomen chez les deux sexes. Le sperme y étant stocké, le mâle commence par remplir ses bulbes copulateurs, initialement vides. Pour cela, il tisse une petite toile spermatique sur laquelle il dépose une goutte de sperme, puis il y plonge ses pédipalpes. Le remplissage se fait ensuite par capillarité.
Une fois prêt, le mâle part en quête d’une partenaire. Parvenu à proximité, il tisse un « fil d'accouplement » dédié à cette rencontre, puis entame une parade faite de petits sauts et de percussions, destinés à signaler ses intentions pacifiques et à calmer l’instinct prédateur de la femelle. Si elle se laisse convaincre, le rapprochement physique peut enfin avoir lieu.
Commence alors une phase aussi délicate que périlleuse : le mâle doit introduire ses bulbes dans les orifices génitaux de la femelle, situés sous l’abdomen.
La femelle, prédatrice opportuniste, peut à tout moment le saisir simplement en refermant ses pattes. Le mâle insère un pédipalpe pour la fécondation, avant de tenter de s’éclipser, car le danger demeure. S’il survit, il devra réitérer la manœuvre avec son second pédipalpe – ce qui semble être la norme chez cette espèce.
L’ironie de cette histoire, c’est que l’ingestion d’un mâle stimule bien plus efficacement la croissance de la femelle qu’une proie ordinaire : il s’agit donc d’un mets de choix. Comme il n’est pas rare qu’une femelle tente de dévorer chaque mâle avant même l’accouplement, ce comportement soulève un paradoxe évident : se nourrir de tous les prétendants ne risque-t-il pas de compromettre le maintien des populations ? Pourtant, ce cannibalisme relève aussi d’une forme de sélection sexuelle : seuls les mâles les plus habiles parviennent à transmettre leurs gènes aux générations suivantes, sans pour autant altérer l’agressivité des femelles, indispensable à l’efficacité prédatrice et dont l’affaiblissement pourrait nuire à la survie de l’espèce.