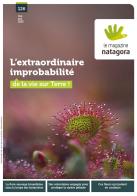Des volontaires engagés pour protéger la vipère péliade
Depuis le début des années 2000, un groupe de travail baptisé GT Serpents s’engage pleinement pour assurer la survie de la vipère péliade sur le sol wallon. Composé notamment d'une quinzaine de bénévoles passionnés, il se consacre à la protection de ce reptile discret et souvent mal compris, victime des préjugés et de l’agriculture intensive. En deux décennies d’efforts soutenus, ces volontaires ont non seulement permis de recenser les populations de vipère en Wallonie, mais ont également fait des découvertes majeures en matière de préservation de cette espèce en danger critique d'extinction.
Ce dimanche 23 mars, Guido Catthoor se promène, comme à son habitude, en bordure d’un bois en Fagne-Famenne. C’est une belle journée : au cours de sa balade, ce volontaire engagé de Natagora a déjà croisé deux vipères péliades (Vipera berus). Dans le courant du mois de mars, il en a observé une quinzaine. Il encode ses rencontres avec des vipères méticuleusement, à chaque sortie, en parallèle des nombreuses autres observations qu’il effectue jour après jour, toujours avec la même passion. Ce travail, il n’est pas seul à le mener. Une quinzaine d’autres bénévoles composent le groupe de travail Serpents de Natagora, soutenus par les chercheurs Thomas Duchesne et Eric Graitson (chercheurs du pôle Herpétologie, la branche de l'histoire naturelle qui traite des amphibiens et des reptiles, au sein de Natagora). Ensemble, ils œuvrent depuis une vingtaine d'années à la survie de la vipère péliade en Wallonie, une espèce de serpent menacée d'extinction.
Deux études majeures menées ces dernières années mettent en lumière le déclin inquiétant de l’espèce. Sa mobilité réduite, sa reproduction lente, ses besoins thermiques et hydriques spécifiques, ainsi que sa vulnérabilité face à la prédation font de la vipère péliade une espèce sensible. À cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique et les pratiques de l’agriculture intensive.
"Autrefois, les agriculteurs travaillaient leurs terres à la main", explique Thomas Duchesne. "Entre les parcelles, il y avait souvent des petites friches non exploitées, où des haies laissées en l’état. Ces éléments offraient des microhabitats pour les vipères péliades." Aujourd’hui, les terrains agricoles sont bien plus vastes, et peu de buissons échappent aux tracteurs qui les labourent. "Les serpents n’aiment pas les milieux homogènes. Ils ont besoin de vivre dans des espaces variés et semi-ouverts pour pouvoir thermoréguler et se cacher des prédateurs."
Au sein même des espaces protégés, les chercheurs ont constaté des régressions de l’espèce. "Par le passé, dans certaines réserves naturelles, l’introduction du pâturage ou le broyage de la végétation sur de trop grandes surfaces ont contribué à l’extinction de certaines populations, heureusement aujourd’hui, on connaît mieux les besoins de l’espèce", explique Éric Graitson.

Discrète et farouche, la vipère péliade évite les espaces découverts où elle risquerait d’être repérée et dévorée, notamment par les sangliers. En Wallonie, ces derniers, devenus surabondants, figurent avec les faisans, parmi ses principaux prédateurs. Développées massivement pour la chasse, ces espèces perturbent l’équilibre naturel. "En effet, les lâchers de faisans contribuent à la disparition des reptiles : ils dévorent les jeunes vipères. Ils tuent même parfois les adultes avant de réaliser qu’ils ne peuvent pas les avaler", explique Thomas Duchesne. "Nous avons montré que la protection de la vipère péliade n’est efficace que si les habitats sont pourvus de nombreux abris, mais aussi qu’ils sont soustraits de l’impact des sangliers", explique Éric Graitson. Enfin, la dernière menace, indissociable des enjeux liés à l’habitat de la vipère péliade, est le réchauffement climatique. La multiplication des épisodes climatiques extrêmes — fortes pluies, vagues de chaleur, sécheresses — contraint davantage ce serpent à rechercher des refuges frais et humides, à l’abri de la lumière. Or, les friches, les buissons ou encore les haies, essentiels à sa survie, sont de plus en plus rares. Leur préservation constitue donc une condition sine qua non de la pérennité de l’espèce.
C’est la raison pour laquelle les volontaires de Natagora jouent, depuis une vingtaine d’années, un rôle crucial dans sa protection par le biais de la gestion des réserves naturelles en Wallonie. "Je suis bénévole pour Natagora depuis 2000. Avant, je vivais en Flandre", explique Guido Catthoor. "Je suis un amateur passionné, et j’ai toujours eu une fascination pour les serpents. Ils mènent une vie discrète et mystérieuse, c’est toujours une aventure." Avec deux autres volontaires, Guido Catthoor est conservateur de la réserve Natagora des Argilières de Romedenne. En plus du suivi régulier des populations de vipères péliades, ils ont pour mission de créer des abris pour ces reptiles, en empilant des branches, en préservant des buissons et en aménageant le terrain avec les ressources disponibles. "La priorité pour la survie des vipères, ce serait d’abord d’agrandir les réserves et les zones protégées", poursuit-il. "Ensuite, il faudrait les connecter entre elles grâce à des corridors naturels faits de petits bois. Cela permettrait aux populations de se rencontrer, de se reproduire et de renforcer leur diversité génétique."
De leur côté, Thomas Duchesne et Éric Graitson expriment leur gratitude envers l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour la survie de la vipère péliade. Ils soulignent l’ampleur du travail accompli. "Plus les bénévoles réalisent du monitoring, plus ils développent un attachement pour les espèces qu’ils recensent. Très vite, ils ne se contentent plus de les compter, mais cherchent aussi des solutions pour améliorer leur habitat", expliquent-ils. Bien conscient des préjugés qui entourent encore la vipère, les deux chercheurs encouragent d’ailleurs toute personne intéressée à se lancer. "C’est inévitable, l’inconscient collectif associe immédiatement les serpents aux morsures. Mais c’est une idée reçue." Pour contrer ces idées fausses, le groupe de travail Serpents s’implique désormais dans des actions de sensibilisation, que ce soit à travers des salons ou les formations en herpétologie proposées par Natagora. Enfin, Thomas Duchesne invite toute personne croisant le chemin d'un reptile (serpent ou lézard) à signaler son observation sur le site destiné à la récolte de données naturalistes : Observations.be.